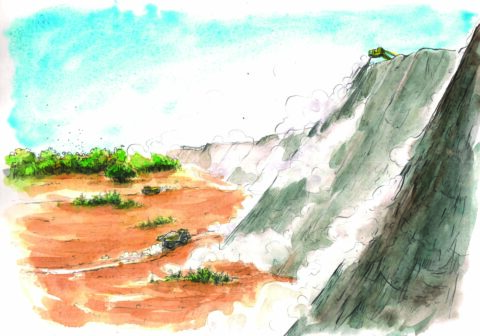• Les deux tiers des salariés étrangers ne restent pas plus de six mois à Saint-Nazaire, emportant avec eux dans leur pays le secret de leurs expositions à des substances dangereuses et de leur état de santé.
• « Sous-traiter en cascade permet de sous-traiter les risques mais aussi de briser le syndicalisme en mettant en concurrence les salariés », raconte André Fadda, ancien soudeur intérimaire et ancien délégué CGT sur le site des Chantiers.
• Le manque criant de médecins du travail et l’absence de formation des médecins de ville aux problématiques de santé au travail à Saint-Nazaire, interpelle la chercheuse Juliette Heinrich.
« Ce que vous voyez sur le côté gauche, c’est le premier de la génération des méga yachts créés ici. Il fait 240 m de longueur pour 29 m de largeur. C’est le très grand luxe ! », commente la guide touristique. Pour les Chantiers de l’Atlantique, cette visite ouverte aux journalistes est l’occasion d’exhiber les joyaux de son imposante vitrine : l’Utopia of the seas, paquebot grand public de près de 7.000 passagers ; le Silenseas et ses voiles en fibre de carbone censées symboliser le nouveau cap écologique de l’entreprise ; et le Jacques-Stosskopf, navire militaire ravitailleur destiné à la Marine nationale.
Les « Chantiers », c’est le royaume des géants : un territoire de plus de 100 ha, où naissent des bateaux toujours plus grands, construits dans des cales à sec et dans d’immenses hangars. L’entreprise emploie plus de 3.700 salariés « maison » et fait travailler entre 5.000 et 7.000 salariés sous-traitants employés par « plus de 600 sociétés », d’après la CGT. Dont beaucoup d’ouvriers régulièrement exposés aux fumées de soudage et autres substances chimiques. Leur réalité est bien éloignée de celle des passagers des paquebots qu’ils bâtissent.

« Un jour, après le travail, je ne me sentais pas bien du tout : j’avais du mal à respirer, j’étais en sueur, j’avais des diarrhées. J’ai cru que j’allais crever. » Loïc* est jeune intérimaire et père de famille. Selon lui, pendant plusieurs mois, l’entreprise sous-traitante pour laquelle il travaillait jusqu’en 2022 lui aurait fait pratiquer de la soudure « inox » (acier inoxydable) sans équipement de protection individuel adapté, sans autorisation, sans licence, sans formation et sans suivi médical adapté. Quatre jours après son malaise, Loïc réalise un test urinaire qui révèle une contamination importante au Chrome VI, un composé métallique très toxique.
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête
« Pendant plusieurs mois, [Loïc] a été exposé aux fumées de soudure inox avec une intoxication au Chrome VI qui a été mise en évidence », confirme sa pneumologue. Après un long arrêt de travail, le jeune homme a fini par retrouver un emploi, mais cette intoxication lui a fait perdre 38 % de capacité respiratoire. « Je ne peux plus souder et je ne peux plus jouer avec mes enfants comme avant, se désole-t-il. Dès que je commence à courir ou à monter des étages, je m’essouffle. » Loïc est en colère. Et inquiet. Afin d’obtenir justice, l’ancien soudeur va attaquer son employeur pour faute inexcusable. Avec ce Chrome VI accumulé dans son organisme, il considère qu’il vit désormais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Les fumées de soudage sont un serpent de mer aux Chantiers. Et un ennemi redoutable pour les travailleurs en raison des multiples composés métalliques qu’elles peuvent contenir (nickel, aluminium, Chrome VI, cuivre, plomb, manganèse…). Depuis 2018, elles sont classées « cancérogène » pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Elles peuvent causer – entre autres – de graves pathologies bronchopulmonaires.
Parmi les différents procédés de soudure utilisés aux Chantiers, la soudure « inox » est particulièrement nocive. Elle dégage du Chrome VI (ou chrome hexavalent), ce métal qui a intoxiqué Loïc, classé cancérogène pour l’homme depuis plus de trente ans. Malgré sa dangerosité, la technique reste massivement pratiquée aux Chantiers, surtout dans les dernières étapes de la construction des bateaux (montage des cuisines notamment), indique la CGT, syndicat majoritaire chez les ouvriers. Comme Loïc, les salariés qui réalisent ces soudures inox travaillent majoritairement pour des entreprises sous-traitantes (« coréalisatrices », préfère dire la direction). Ils sont, en principe, soumis à un protocole obligatoire très strict : aspiration à la source, cagoule hermétique avec ventilation assistée, test urinaire tous les vendredis pour contrôler le taux de Chrome VI, etc. Sauf dérogation, cette technique de soudage est interdite aux intérimaires, « pour une raison de suivi médical. Un salarié Chantiers est plus facile à suivre. Un intérimaire, c’est pas très cadré », détaille la CGT.

Mais, comme nous le montre le cas de Loïc, la réglementation est loin d’être toujours respectée : le procès-verbal du médecin de travail pointe très clairement les infractions au code du travail commises par l’employeur. « À bord des navires, affirme quant à lui Loïc, beaucoup d’autres salariés sont contaminés, souvent sans le savoir. » Les plus exposés seraient les travailleurs détachés (étrangers), souvent originaires des pays de l’Est (Pologne, Bulgarie, Moldavie, Ukraine, etc.), très nombreux sur les ponts des navires.
Combien sont-ils ? Des sociologues ont évalué à 20.000 le nombre de salariés étrangers déclarés entre le 1er janvier 2016 et le 1er juin 2019 dans le bassin nazairien (Chantiers de l’Atlantique, Airbus et raffinerie TotalEnergies). Grâce à une autre enquête réalisée en 2018 par l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire, nous savons que les deux tiers d’entre eux ne restent pas plus de six mois dans l’agglomération. Ils repartent ensuite dans leur pays en emportant avec eux le secret de leurs expositions et de leur état de santé. « Certains n’hésitent pas à se mettre en danger pour des salaires jusqu’à dix fois supérieurs à ce qu’ils gagneraient chez eux », estime Sébastien Benoît, délégué CGT.
Sous-traiter les risques grâce à un « montage exotique »
En cas d’accident ou de non-respect de la réglementation de la part d’un de ses sous-traitants, les Chantiers leur opposent le Recueil des principales règles HSE. Un pavé de 529 pages, qui détaille les procédures à respecter en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, mis en place afin de préserver la santé des travailleurs. « Ce document leur permet de rejeter la responsabilité sur leurs sous-traitants, estime un autre élu CGT sous couvert d’anonymat. Les travailleurs étrangers soudent de l’inox à tout-va et les Chantiers ferment les yeux là-dessus ». La sous-traitance en cascade, très fréquente sur les navires, brouille les pistes et dilue les responsabilités, insiste ce délégué syndical. Un prestataire français va, par exemple, sous-traiter à des sociétés italiennes qui, à leur tour, vont faire travailler des salariés roumains œuvrant pour d’autres entreprises.
De son côté, la CFDT, syndicat minoritaire chez les ouvriers, préfère voir le verre à moitié plein. Son représentant, Jérôme Dholland, considère que depuis son arrivée dans l’entreprise il y a 24 ans, il y a eu « de réels progrès » en matière de protection des salariés exposés aux fumées de soudage. « Aujourd’hui, les sous-traitants et les Chantiers font mieux appliquer les règles », affirme-t-il, évoquant l’exemple des « cartons jaunes » mis en place il y a quelques années pour pénaliser ceux qui « ne travaillent pas dans des conditions sécurisées ». « Je ne crois pas à une mise en danger délibérée de la part des Chantiers », soutient le responsable syndical, tout en concédant toutefois :
« On sent qu’il va falloir trouver d’autres moyens de faire passer le message. L’exemple de l’amiante nous a aussi montré que certaines choses pouvaient être des bombes à retardement. »
Nous aurions aimé connaître les actions mises en place par l’entreprise pour s’assurer que les milliers de salariés travaillant sur son site sont protégés et suivis médicalement. Mais le service communication n’a répondu à aucune de nos sollicitations.
Le recours massif à une main-d’œuvre étrangère aux Chantiers de l’Atlantique ne doit rien au hasard. C’est un choix qui remonte au début des années 2000. En octobre 2001, une note de la direction intitulée sans complexe « montage exotique » est envoyée aux entreprises sous-traitantes. Objectif : organiser la venue à Saint-Nazaire d’une main d’œuvre en provenance de pays « à faible coût », à savoir du « Maroc, de l’Ukraine, du Portugal et des Émirats Arabes », peut-on lire dans le document.

Vingt-trois ans plus tard, les travailleurs sous-traitants et intérimaires, étrangers et français, constituent l’une des pièces maîtresses du grand Mecano des Chantiers. « Dans les années 1990, on avait un collectif CGT intérimaire extrêmement puissant, très efficace sur la défense de la santé et sécurité au travail, se souvient André Fadda, ancien soudeur intérimaire et ancien délégué CGT sur le site des Chantiers. Sous-traiter en cascade de façon massive avait un objectif pour les employeurs : sous-traiter les risques, c’est-à-dire se défausser de leurs responsabilités. Mais aussi briser le syndicalisme en mettant en concurrence les salariés. La pression est tellement forte, avec les contrats à la semaine, que tu as des gars qui finissent par accepter de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses ». Et d’ajouter : « À partir du moment où il y a eu moins de militants sur les lieux, la dégradation des conditions de travail s’est alors vraiment accélérée… ».
Des entorses à la réglementation sont monnaie courante
L’exposition aux fumées de soudage est-elle limitée aux sous-traitants ou concerne-t-elle aussi les salariés « maison » ? Sur les 3.000 à 4.000 ouvriers maison que comptaient les Chantiers il y a 25 ans, il n’en reste plus qu’un millier. Une partie travaille à l’atelier panneaux plans. Ici, pas de Chrome VI, mais beaucoup de fumées.
« On est bien équipés, nous raconte Eliott*, un jeune soudeur. On porte une cagoule ventilée et il y a des systèmes d’aspiration des fumées sur les postes. » Mais la quête de la protection parfaite a ses limites, tempère-t-il. « La direction nous pousse maintenant à utiliser des torches aspirantes qui sont très lourdes et pas faciles à manier. On commence à avoir des tendinites et d’autres marques d’usure. » Ici, se protéger des gaz et des poussières toxiques n’est pas non plus une mince affaire. « Le problème, poursuit Eliott, c’est surtout quand on circule, quand on enlève la cagoule… Il faudrait porter tout le temps un masque “nez de cochon” (FFP2). Quand il fait chaud, c’est compliqué et quand tu portes tes lunettes de protection, ça fait de la buée. »

Pas moins de trente entorses à la réglementation en matière d’exposition aux fumées de soudage ont été enregistrées durant les années 2021 et 2022 par les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) à la suite d’inspections à bord des navires. Ce constat demeure très incomplet, car les élus du personnel ne disposent que d’une heure tous les quinze jours pour contrôler un navire dans sa totalité. Pour Sébastien Benoît, représentant CGT, une chose est sûre :
« Les infractions sont récurrentes. Je vois tous les jours des sociétés sous-traitantes qui laissent leurs salariés souder sans masques adéquats. »
Au fond du navire, les galériennes du nettoyage
Pendant que les soudeurs opèrent au milieu des nuages de fumée, des femmes et des hommes, employés d’une société de nettoyage sous-traitante, respirent au quotidien toutes sortes d’effluves (carburants et solvants) extrêmement nocives pour la santé. Leur mission : livrer à l’armateur, dans les délais fixés, un navire d’une propreté irréprochable.
C’est au fond du bateau, en salle des machines, sous le plafond des ballasts, que les conditions de travail sont les plus dangereuses et les plus pénibles. Toute la journée, il faut ramper, dans une chaleur étouffante, entre les tuyaux brûlants, pour aller aspirer les fuites d’huile, de gasoil ou de fioul lourd (très visqueux) dilué au dégoudronnant.
Christelle* l’a fait pendant des années. « Une fois, il y a eu une fuite de fioul lourd qui a duré huit jours : on est restés toute la semaine dans le fioul… Quand on ressortait, on en avait parfois sur nos vêtements ou sur la peau, mais il n’y avait pas de douche, on rentrait chez nous comme ça ! », s’indigne-t-elle. Il y a quatre ans, Christelle découvre qu’elle est atteinte d’un cancer de la vessie. Malgré l’appui de son médecin, sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle est refusée. Car son cancer ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles associées à son emploi.

Une situation malheureusement courante car ces tableaux sont construits « sur des critères arbitraires et souvent décourageants », déplore le Dr Philippe Deguiral, un oncologue qui a exercé pendant 26 ans à Saint-Nazaire : « Pour avoir une reconnaissance en maladie professionnelle, il faut rentrer dans les cases, prouver qu’on a été exposé pendant un certain temps et ne pas dépasser le délai de prise en charge », détaille-t-il. À 50 ans, Christelle a pourtant été reconnue « travailleur handicapé » par la sécurité sociale et « inapte au poste» par la médecine du travail. Elle pourra reprendre un poste, mais « sans aucun contact avec des produits chimiques », « sans montée/descente répétée d’escaliers, sans contraintes de postures prolongées, sans manutention ».
Cette absence de reconnaissance est vécue comme une insupportable injustice par ses collègues. « J’en suis certaine, son cancer de la vessie est dû aux hydrocarbures, au fioul lourd ou aux produits chimiques qu’on utilise à bord », affirme Marie*. Si elle ne travaille pas en machine comme Christelle, Marie a aussi eu sa dose de produits toxiques : « Pendant quinze ans, on a frotté à mains nues les panneaux inox des bateaux avec un puissant dégraissant. C’est le seul qui marchait. Et un jour, mon chef m’a dit qu’il ne fallait plus l’utiliser, il est CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction). Il y a des produits comme ça qu’on a utilisés pendant des années avant qu’ils soient interdits. Il faut que ça change. Pour nos gosses. Nous, on est foutues ! », déplore-t-elle.
Si Marie admet être mieux protégée qu’à ses débuts, dans les années 1990-2000, elle explique qu’avec la chaleur et la buée, garder le masque toute la journée est tout simplement impossible. En plus de travailler dans des conditions de travail très pénibles, Christelle et Marie estiment être très mal formées et informées par leur employeur sur la nature des substances qu’elles utilisent et leurs conséquences sanitaires. Elles s’étonnent de ne pas avoir de suivi médical spécifique. « On n’a jamais de test urinaire ou de bilan sanguin, s’exclame Marie. Moi, ça fait au moins deux ans que je n’ai pas vu de médecin du travail. »

Aux Chantiers, le thermomètre est cassé. Une partie importante des personnels exposés à des substances toxiques semble passer sous les radars de l’inspection et de la médecine du travail. Interrogée par Splann !, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) Pays de la Loire n’a pas souhaité apporter d’informations sur les Chantiers ou toute autre entreprise inspectée. Son directeur adjoint, Philippe Caillon, affirme ne pas pouvoir quantifier « le nombre d’infractions constatées [dans l’agglomération] avec leur nature précise ». Il ajoute que « des décisions d’arrêt d’activité ont été prononcées suite au constat de l’exposition de salariés à des substances contenant du Chrome VI ». Et ajoute : « les services de l’inspection du travail interviennent régulièrement sur la problématique de l’exposition à des polluants exposant à des agents CMR (Chrome VI, fumées de soudages…) dans les secteurs de la métallurgie, de la construction navale, de l’aéronautique et du BTP. On constate souvent l’absence de captation à la source des fumées et/ou de mise à disposition de protections individuelles adaptées. » Quant aux quatre médecins du travail de l’agglomération que nous avons contactés, aucun n’a donné suite à nos demandes d’entretien.
« Il existe peu de données sur le suivi des salariés. Et la sous-traitance rend probablement plus difficile encore la production de ces données, car certaines personnes peuvent travailler pour plusieurs groupes industriels et subir des expositions multiples », témoigne le Dr Juliette Heinrich qui a soutenu sa thèse de médecine en novembre dernier sur « les facteurs de risque de cancer » dans l’agglomération nazairienne. Au cours de ses recherches, elle a été frappée par le manque criant de médecins du travail et l’absence de formation des médecins de ville aux problématiques de santé au travail dans cette agglomération, notamment au vu des nombreuses entreprises qui la peuplent [Regardez notre carte interactive].
« Aujourd’hui, hormis pour les expositions à l’amiante, bien peu de cancers sont reconnus en maladie professionnelle, privant les personnes exposées de leurs droits ». Comme Loïc, notre témoin intoxiqué au Chrome VI, combien devront se battre pour prouver le lien entre leur travail et leur maladie ?
*Le prénom a été changé à la demande de la personne, afin de préserver son anonymat.
Airbus Atlantic : les zones d’ombre d’une réussite économique
Soixante-cinq milliards d’euros de chiffre d’affaires et 735 avions commerciaux livrés : 2023 fut une belle année pour le groupe Airbus. Une réussite économique à laquelle sa filiale Airbus Atlantic, qui compte des sites de production à Nantes, Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire (44), a bien contribué. Mais ces performances économiques se traduisent aussi par une hausse des cadences depuis deux ans pour les 6.000 employés (hors intérimaires et sous-traitants) de ces trois sites.
« Les risques psychosociaux, c’est une très grosse problématique, ça explose ! Il faut livrer en temps, en heure, en qualité », s’inquiète Karl Mahé, secrétaire général CGT à Airbus Saint-Nazaire. Ces RPS viennent s’ajouter à une vieille problématique : l’exposition à des substances toxiques.
Le rapport 2022 de la médecin du travail d’Airbus Atlantic Saint-Nazaire, que nous nous sommes procuré, pointe un seul cas de cancer (du poumon) professionnel au cours des années 2021 et 2022. Mais ce document ne concerne que les employés d’Airbus et ne tient donc pas compte des intérimaires et sous-traitants, pourtant très exposés, notamment au dioxyde de manganèse, une substance nocive par inhalation, libérée lors de l’application de mastic.
Sur un total de 899 salariés, le rapport établit à 122 le nombre de travailleurs soumis au risque « CMR » (cancérigène, mutagène, reprotoxique), à 509 le nombre de ceux qui sont exposés à des solvants organiques et à 107 le nombre de personnes exposées à de l’acide chromique ou à des chromates et bichromates alcalins. « Des solutions sont actuellement étudiées pour réduire au maximum l’exposition aux produits chimiques et tout particulièrement au chrome », assure la médecin du travail dans le rapport.
Karl Mahé, lui, reproche à la direction d’être plus attentive au risque de tendinite d’un salarié en activité qu’au risque qu’il développe un cancer après sa retraite, même s’il reconnaît qu’elle se penche aujourd’hui sur la question des expositions chroniques. Un autre élu affirme que la médecin du travail ne participe plus, depuis deux ans, aux réunions de Comité social et économique (CSE) comme elle le faisait auparavant. « Je pense qu’elle subit des pressions pour ne pas venir », souffle-t-il. À moins qu’elle n’ait tout simplement plus le temps d’y aller vu la pénurie actuelle de médecins du travail ?
Des informations à nous communiquer ?
Écrivez-nous à contact [@] splann.org et nous vous expliquerons comment nous joindre des documents de façon sécurisée.
Contactez-nous →