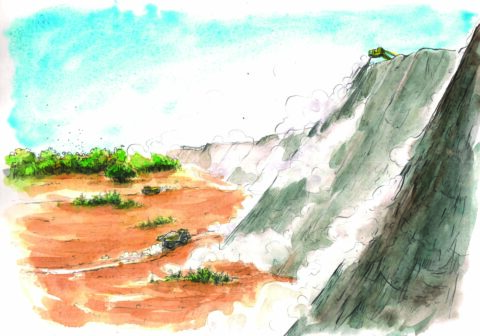À l’ombre des Safer, la guerre des champs, les coulisses de l’enquête avec Julie Lallouët-Geffroy
En septembre 2023, nous publiions une grande enquête sur la bataille pour le foncier agricole et les contournements de la Safer en Bretagne. Son autrice principale, Julie Lallouët-Geffroy, revient sur les coulisses de ce travail.
40 000 fermes en moins entre 2020 et 2023, en France métropolitaine, une surface moyenne passée de 76 ha à 93 ha depuis 2010, une forte progression des fermes de plus de 200 ha… Une enquête publiée en juin 2025 par l’Agreste confirme le mouvement de concentration des exploitations françaises observé depuis la moitié du XXe siècle et que la loi Duplomb devrait encore accentuer.
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 3,6 % par an, depuis 2020, pour s’établir à 349 600 (hors Drom). « Cette accélération concerne surtout les micro-exploitations, en lien avec les changements intervenus en 2023 dans les conditions d’attribution de la PAC, qui sont désormais réservées aux agriculteurs dits actifs », indique le service de la statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture.
Hors micro-exploitations, la baisse s’établit à 1,7 % par an, soit le même rythme que durant la décennie précédente.
Seule la tranche des fermes disposant de 200 ha ou plus progresse, avec une hausse annuelle de 2,8 %. « Si cette tendance était déjà à l’œuvre par le passé, elle s’intensifie : près de 780 fermes supplémentaires chaque année entre 2020 et 2023, soit environ 20 % de plus qu’au cours de la décennie précédente », note l’Agreste. Résultat, celles-ci représentent désormais une exploitation sur dix et concentrent un tiers des terres agricoles métropolitaines.
Le nombre d’exploitations spécialisées dans l’élevage a diminué, en particulier pour les bovins (lait et viande). Toutes espèces confondues, le cheptel a baissé de 4,4 % tandis que le nombre d’animaux par ferme a augmenté, passant de 151 à 155 unités gros bétail entre 2020 et 2023.
Les effectifs agricoles baissent de 1,4 % par an, en moyenne, pour s’établir à 608 900, hors micro-exploitations, en 2023.
Si les exploitants et leur famille assument toujours la majeure partie du travail, l’emploi non familial progresse. Les salariés permanents non familiaux et la main d’œuvre saisonnière ou occasionnelle représentaient 40 % des équivalents temps plein en 2023, contre 30 % en 2010. Les travaux externalisés à des entreprises de travaux agricole ou à d’autres prestataires augmentent fortement, passant de 22 500 à 35 00 emplois à temps plein, en trois ans.
« Cette évolution est la conséquence directe d’une PAC qui favorise les grandes exploitations qui touchent le plus de subventions et ont les revenus les plus élevées, analyse Philippe Pointereau, président de Terre de liens et cofondateur de Solagro. Autre fait inquiétant, la surface agricole utile de ces exploitations professionnelles recule de 161 300 ha entre 2020 et 2023 soit une perte de 54 000 ha par an. Cela s’explique par une artificialisation des sols toujours importante, mais aussi par un abandon des terres les moins « productives » lié à cet agrandissement des fermes et leur spécialisation croissante. »
Dans ce contexte, plusieurs décisions politiques récentes, réclamées par la FNSEA, devraient accentuer l’agrandissement des exploitations et la concentration des terres, au détriment de l’agriculture biologique et familiale.
Des dispositions de la loi Duplomb ayant échappé à la censure du Conseil constitutionnel vont dans ce sens. Il s’agit du relèvement des seuils de contrôle pour les élevage hors-sols de taille moyenne. Une évaluation environnementale stricte ne sera plus nécessaire entre 2 000 et 3 000 porcs ainsi qu’entre 40 000 et 85 000 volailles, sachant que la plupart des élevages bovins échappent à toute procédure.
La loi facilite aussi la construction de méga-bassines pour l’irrigation en les déclarant d’intérêt général. Cela réduit les procédures de contrôle environnemental et permet leur déploiement rapide, au profit de grandes exploitations intensives, mais au détriment des zones humides.
Les promoteurs du texte n’ont par ailleurs pas abandonné l’idée de permettre la réintroduction de plusieurs pesticides néonicotinoïdes, au risque de renforcer la dépendance aux intrants chimiques.
Dans le même temps, le soutien à l’agriculture biologique se réduit. L’Agence Bio a ainsi vu ses financements fondre. Son existence même étant remise en cause.