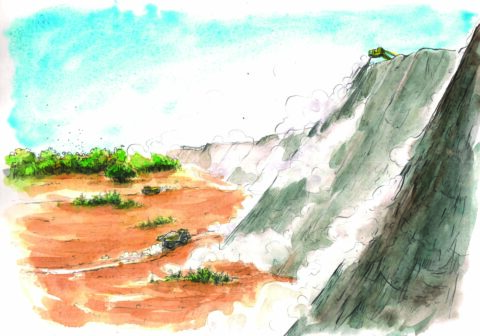« Comment j’ai travaillé avec des scientifiques dissidents », Inès Léraud, le 24 mai 2023
Inès Léraud a été invitée à s’exprimer sur ses relations avec les scientifiques dans le cadre de ses enquêtes sur la santé et l’environnement, lors de la journée Sciences et médias organisée par l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI) et plusieurs sociétés savantes, le 24 mai 2023, à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand.
Au cours de ses travaux sur les malades du mercure, l’exposition des ouvriers de l’agroalimentaire à des substances toxiques ou encore les algues vertes en Bretagne, la reporter a rencontré de nombreux chercheurs.
« Souvent, de façon a priori inattendue, les scientifiques ont été des freins à mes enquêtes et ce sont également des personnes auxquelles j’ai dû me confronter tout autant que les industriels », observe Inès Léraud.
La journaliste prend l’exemple d’Ellen Imbernon directrice du service santé travail à l’Institut de veille sanitaire (INVS, devenu Santé publique France 2016), rencontrée au cours de son enquête sur les malades du cancer chez Adisseo, à Commentry (03) pour Là-bas si j’y suis, sur France Inter, en 2011.
La médecin du travail épidémiologiste a dirigé une étude confirmant le lien entre l’exposition au C5 et le développement de cancers. Cette molécule est alors utilisée dans un procédé industriel de fabrication de vitamine A, destiné à stimuler la croissance animale. Pour autant, l’INVS n’a pas demandé le classement du C5 comme cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR).
« Il y en a des tas de produits comme ça dans l’industrie chimique, tempère Ellen Imbernon. Nous, on informe la société, maintenant la société prend ses décisions, parce qu’il y a d’autres enjeux, il faut bien en avoir conscience. Des enjeux face à l’emploi, des enjeux économiques. Voilà, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? »
Lors d’un autre reportage, Inès Léraud interviewe Alain Rannou, expert de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Elle l’interroge sur un accident survenu à Saint-Maur-des-Fossés (94), où les locaux de 2M Process, un sous-traitant du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), ont été contaminés par du tritium, à proximité d’un collège et d’habitations.
« Il faut rappeler qu’il y a des incertitudes sur les effets des rayonnements ionisants à faible et très faible dose, déclare Alain Rannou dans un enregistrement. Il faut avoir l’esprit de responsable. Laisser penser à des personnes qu’elles sont exposées à un risque, ça peut avoir des conséquences autrement plus importantes que le risque réel. Le stress peut être un facteur de risques. »
Inès Léraud déplore que certains scientifiques aient intégré le fait qu’ils produisent « une sorte de connaissance bureaucratique, qui n’a pas vocation à agir sur le réel. »
« Cette façon d’appréhender l’exercice du métier de scientifique, qui ça sert finalement ? À mes yeux, davantage le secteur industriel ou économique que les citoyens », tranche-t-elle.
« Ce ne sont pas du tout des gens corrompus, souvent pas des gens qui ont des conflits d’intérêts, pas du tout des personnes au service de lobbys. Elles travaillent souvent pour le service public, sont respectées par leurs pairs. Et pourtant, elles peuvent participer à la fabrique du doute, voire à des communications mensongères qui servent les intérêts des industriels. »
Des contre-exemples existent. Inès Léraud cite Henri Pézerat pour son combat contre l’amiante, Irène Frachon, pneumologique brestoise qui a mis au jour le scandale du Mediator ou encore Pierre Philippe, l’urgentiste de l’hôpital de Lannion qui a fait le lien entre les algues vertes en décomposition et des intoxications, parfois mortelles, à l’hydrogène sulfuré.
Ces scientifiques devenus lanceurs d’alerte ont chaque fois dû batailler face à leur administration, en dépassant la fonction qui leur était assignée. Inès Léraud les décrit comme des dissidents, isolés, non corporatistes et pas valorisés par leur hiérarchie.
« Chez eux, la production de connaissances s’accompagne d’une remise en question profonde et de critiques radicale à l’égard des institutions pour lesquelles ils travaillent. Comme si l’institution était un cadre contraignant, qui incite au silence, presque carcéral, contradictoire avec l’exercice d’une science libre et du bien commun », conclut-elle.