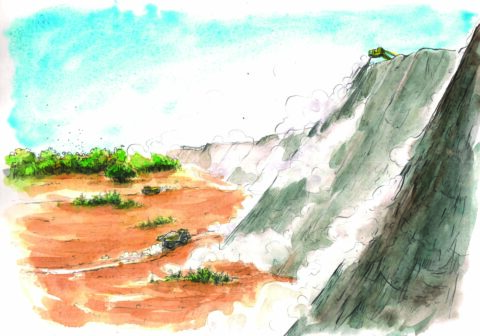- Comme de nombreuses autres femmes, la briochine Isabelle Ellis témoigne de son calvaire et de son errance médicale qu’elle attribue aux implants de contraception définitive Essure.
- Avec une chercheuse brestoise, elles ont mené des analyses à leur compte, mettant en évidence la piste prometteuse de la toxicité de l’implant. Ces résultats ont bousculé les autorités sanitaires.
- Grace à la persévérance des associations de patientes, une recherche nationale sur les implants de contraception définitive Essure devrait débuter en 2023, soit plus de 20 ans après leur mise sur le marché.

Isabelle Ellis a 54 ans et habite à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor. Ancienne infirmière, elle est aujourd’hui psychothérapeute pour enfants.Alors qu’elle recherchait un moyen de contraception définitive, Isabelle se fait poser le dispositif Essure le 21 août 2008, deux petits implants en alliage métallique introduits dans les trompes de Fallope. Au bout de quelques mois, Isabelle rencontre de légers problèmes respiratoires. La dégradation de son état de santé est ensuite brutale : pneumonie, difficultés cognitives, perte d’énergie croissante jusqu’à la chute et des douleurs musculaires qui la handicapent à tel point qu’elle doit utiliser un fauteuil roulant.
Isabelle en est convaincue : « Essure a pris dix ans de ma vie, c’était l’horreur. Je me sentais dans un corps de vieille dame, avec des douleurs partout et l’impossibilité de me déplacer. Mon mari m’amenait aux toilettes », confie-t-elle, depuis son cabinet de thérapeute à Langueux. Une période de souffrance extrême qui a été aggravée par une errance médicale insupportable.
Car à l’époque, Isabelle ne comprend pas d’où viennent ces douleurs. Et, malgré une batterie d’examens, aucune piste d’explication n’est trouvée. Elle ne soupçonne alors pas le dispositif implanté dans ses trompes de Fallope.
« Petit à petit, je me sentais partir. Mon corps s’éteignait, et j’ai commencé à prendre mes dispositions, au cas où je ne me réveillerais plus le lendemain. »
Près de 30.000 femmes explantées en France
En difficulté à tous les niveaux de sa vie, Isabelle Ellis tombe sur Internet sur des témoignages d’autres femmes porteuses des implants Essure, dans lesquels elle se reconnaît. Après avoir fait ses propres recherches et contre l’avis de certains médecins, elle demande alors à être explantée en 2016. Le dispositif n’ayant pas été prévu pour être retiré, les femmes doivent subir une ablation des trompes, voire de l’utérus. L’effet fut, selon Isabelle, presque immédiat. « Cela tenait du miracle », confie-t-elle. « En quelques mois, j’ai retrouvé l’usage de mes jambes et les douleurs ont disparu ».
Après le temps de la guérison, vient celui de la lutte. Isabelle se donne pour mission de mener le combat aux côtés d’autres victimes. Elle prend conscience de l’ampleur du sujet : plus de 200 000 femmes en France sont porteuses du dispositif Essure et, au moment de la pose, les médecins ne les ont pas informées des risques liés à leur implantation. Certaines, comme Isabelle, ont vécu un véritable calvaire.

Victimes de violences gynécologiques à plusieurs niveaux, certaines se sont aperçues que leur implant avait migré dans l’utérus, voire leur avait perforé les trompes. Pour retrouver un semblant de vie « normale », environ 30.000 femmes ont été explantées à ce jour en France.
Mais l’explantation ne signifie pas forcément la fin du calvaire. Sans technique de retrait homogénéisée dans un premier temps, la « casse » a été catastrophique, rapportent les associations de victimes. Certains chirurgiens auraient tenté de retirer l’implant en tirant dessus, engendrant une rupture de celui-ci. D’autres opéraient à l’aveugle sans vérifier si l’implant était toujours en place.
Malgré tous ces retours, la plupart des femmes ont vu leur état de santé s’améliorer radicalement après leur explantation. Mais, à ce jour, aucune recherche ne montre le lien direct entre les implants et les symptômes des patientes, et les victimes françaises n’ont reçu aucune reconnaissance judiciaire de leur calvaire. Bayer n’a été condamné qu’une fois à indemniser une femme pour les effets secondaires causés par les implants Essure, en Espagne. Aux États-Unis, face à 39.000 plaintes déposées, la multinationale a préféré débourser plus d’un milliard de dollars en lieu et place du procès. En France, l’association Resist a tenté une action de groupe pour faire condamner le groupe. Leur action a été déboutée en mai 2022.

« Vous avez Tchernobyl dans le bide »
Ce lien entre ces douleurs et les implants, Isabelle est bien déterminée à l’établir. Elle a créé sa propre association bretonne, Alerte Contraception, en 2018. La Briochine assiste pendant plusieurs années à la lente mise en route de la machine étatique face à des alertes de plus en plus nombreuses.
Un comité de suivi est créé en 2017 (voir« Un rapport fantôme de l’ANSM met en doute la sécurité de l’implant » et « Le contrôle défectueux des autorités sanitaires »), puis un deuxième en 2020, pour finalement aboutir à une recherche nationale dont on attend le lancement, soit vingt ans après la mise sur le marché de l’implant et cinq ans après son retrait.
En parallèle, Isabelle et son association décident de poursuivre la piste d’une possible toxicité de l’implant et de l’effet potentiel des métaux lourds sur le corps des femmes. Elle rencontre la chercheuse brestoise Sidonie Révillon, géochimiste spécialisée en traçage isotopique (technique permettant de caractériser la provenance des matériaux, NDLR), chercheuse associée au laboratoire Geo-Ocean (Univ. Brest, CNRS, Ifremer) de l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) et dirigeante de la société Sedisor, qui propose des services d’analyse et d’expertise en géochimie des éléments et géochimie isotopique.

Celle-ci va effectuer, bénévolement et de sa propre initiative, des premières analyses, dès 2018, sur les trompes d’une femme qui a accepté de fournir l’échantillon de son explantation en toute discrétion. Le but : déterminer « l’ADN » des métaux qui composent l’implant afin d’étudier s’ils sont éparpillés dans le corps. Les résultats montrent des petites concentrations de fer et de nickel dans les tissus des trompes de Fallope analysées et encouragent à aller plus loin afin d’en déterminer les doses.
Sidonie et Isabelle parviennent à exposer leur test de tissus humains en contact avec les implants Essure à une toxicologue qui leur glisse cette phrase sans appel : « Vous avez Tchernobyl dans le bide ». « Certaines femmes porteuses des Essure étaient malades », explique la chercheuse. « Après le retrait des implants, leur état s’est pour toutes au minimum amélioré, la culpabilité du dispositif ne pouvait pas être plus claire », ajoute-t-elle.
Ces résultats, qui suggéraient un lien entre la diffusion de métaux dans le corps des femmes et leurs symptômes, sont présentés pour la première fois à l’ANSM en janvier, puis en octobre 2019. « Ils ne s’y attendaient pas du tout, la première réunion a eu lieu comme clandestinement… Ils nous ont fait passer par une porte arrière, sans traces de notre venue dans les registres… », se souvient Isabelle. Avec Sidonie, elles demandent le lancement d’une recherche nationale plus poussée afin de poursuivre le travail entamé. C’est gagné, le ministère – qui assure qu’il s’agissait d’une réunion officielle – accepte.
Désaccord entre le ministère de la Santé et l’ANSM
Mais, quelques mois plus tard, lorsque Isabelle et Sidonie reçoivent le protocole élaboré par le gynécologue lyonnais Gauthier Chêne, missionné par le ministère de la Santé, elles tombent des nues. Sidonie Révillon, chercheuse brestoise, est écartée de la recherche nationale, et l’étude intègre plusieurs gynécologues connus pour être pro-Essure (voir encadré « La main mise de Bayer sur les gynécologues ») et que les victimes affirment éviter à tout prix. Pratiquement aucune mention n’est faite des métaux lourds. « Ils nous ont totalement évincées, raconte Sidonie. Même les associations de victimes ont été complètement mises de côté dans l’élaboration du protocole. » Sollicité par Splann ! Gauthier Chêne n’a pas souhaité répondre à nos questions.
Résultat : une recherche qui ne convient pas aux principales intéressées, car elle s’étalerait sur une durée de 15 ans ! L’âge moyen des femmes implantées étant généralement au-dessus de 55 ans aujourd’hui, les victimes pourraient ainsi voir leurs pathologies reconnues publiquement (voire dédommagées) lorsqu’elles auront plus de 70 ans ! « Qui peut croire que dans 15 ans, quand vont sortir les résultats de cette étude, ce ne sera pas un flop ? », s’emporte la présidente de l’association bretonne. « Ce n’est pas dans 15 ans qu’il faut proposer quelque chose, c’est maintenant qu’il faut réagir ! ».
En colère, les associations de victimes Alerte Contraception et Victimes DMI envoient un courrier au ministère de la Santé, le 15 février 2022, et obtiennent une réunion afin « d’échanger sur les points de désaccord ».

Entre-temps, et grâce à ses contacts dans le monde médical, Isabelle envoie également un message personnel à Christelle Ratignier, directrice de l’ANSM (Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé), qui lui propose dans la foulée une réunion « off », en tête-à-tête. Isabelle fait le constat que la directrice est peu au courant du dossier, mais elle affirme qu’elle a finalement rejoint son avis quant à l’incohérence de l’étude proposée par le ministère. Sollicité par Splann !, Christelle Ratignier n’a pas répondu à nos questions.
À Paris, le 20 mai 2022, alors que Sidonie et Isabelle s’apprêtent à exposer leurs arguments devant la délégation du ministère, Christelle Ratignier s’invite à la réunion, nous raconte Isabelle. « Visiblement, elle n’avait pas prévenu de sa venue, souffle-t-elle. C’était assez ubuesque, ils ont mis dix minutes à s’en remettre et à vraiment démarrer la réunion. » La présidente d’Alerte Contraception commence par faire un tour de table des présents afin de déterminer leur niveau de connaissance, « et ils n’ y connaissaient pas grand-chose… », déplore-t-elle.
Sidonie propose alors un complément de recherche sur les métaux, basé sur les résultats préliminaires obtenus avec ses analyses. « Sans pour autant se substituer aux études cliniques », la chercheuse estime que les travaux sur les métaux sont essentiels pour déchiffrer les problèmes liés à l’implant. « Christelle Ratignier a été tout de suite emballée par le projet, c’est une biologiste aussi !, s’exclame Isabelle. Elle a demandé à ce que (le lancement de, NDLR) la recherche nationale soit retardée pour ne pas financer quelque chose qui va passer à côté de l’essentiel. Les autres présents étaient très réticents, mais ont dû accepter. »
Quant à l’étude de Sidonie Révillon, elle devrait être menée dans les prochains mois, en complément d’une recherche nationale réorientée. L’ANSM s’est engagée à explorer un financement en ce sens, notamment auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) une fois le protocole proposé par la Brestoise validé et une équipe de chercheurs réunie. « Je ne suis qu’un maillon de la chaîne », souligne Sidonie Révillon, « je connais les outils et les méthodes, mais nous devons réunir une équipe autour de ces problématiques pilotée par des spécialistes de la santé humaine ».
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que la recherche nationale débutera finalement début 2023, assure la Direction générale de la santé (DGS). La proposition de la chercheuse brestoise n’a, pour l’instant, pas reçu de feu vert. Mais les deux Bretonnes restent attentives : pas question de lâcher l’affaire.
« On les prend pour des hystériques »
La longue errance des victimes de l’affaire Essure doit beaucoup au manque d’écoute de la gynécologie française, qui est restée aveugle à leurs souffrances.
Malgré de nombreux effets indésirables parfois invalidants (écouter notre podcast), les victimes de l’affaire des implants Essure ont rencontré une forte indifférence, voire du mépris, d’une partie des gynécologues.
Comme la Morbihannaise Sophie Meledo. Après dix années de souffrances, elle fait le lien avec les implants Essure en 2020 mais « n’est pas prise au sérieux » par sa gynécologue. « Elle m’a dit : « de toute façon, comment pouvez-vous prouver que les problèmes que vous me décrivez sont liés aux Essure ? Si vous voulez que je vous les enlève, je vais vous les enlever, mais il s’agit d’une opération de confort ». »
Un manque de dialogue qui est de plus en plus dénoncé par les associations, comme le prouve la récente polémique autour des violences gynécologiques. Peu étonnant, donc, que nombre de patientes expliquent ne pas avoir eu le choix de leur méthode de contraception définitive. « Il aurait fallu que les femmes puissent choisir et qu’il y ait une vraie discussion médecin-patiente. C’est cette mentalité surplombante qu’il faut travailler », analyse le docteur Sylvain Bouquet, médecin généraliste qui a participé au Comité scientifique ayant évalué le dispositif Essure en 2017 (voir « Un rapport fantôme de l’ANSM met en doute la sécurité de l’implant »).
L’effet Placebo
Certains gynécologues attribuent l’origine des maux à l’arrêt de la pilule : les douleurs gynécologiques des femmes porteuses des implants Essure seraient liées à un vieillissement de l’utérus (adénomyose ou endométriose interne à l’utérus), fréquent chez les femmes de plus de 40 ans. « Elles se retrouvent avec des symptômes qui correspondent à ce que tout le monde a. Il est rentré dans la tête d’un certain nombre de femmes que c’était lié à l’implant Essure », affirme ainsi le professeur Hervé Fernandez, gynécologue et membre de la commission Essure au Collège national des gynécologues obstétriciens de France (CNGOF).
Les symptômes, des règles douloureuses, n’expliquent cependant pas l’ensemble des effets secondaires rapportés par les victimes des implants. Une partie de la profession continue pourtant de défendre les implants Essure. Et de douter du témoignage des victimes, comme le docteur Lopes – gynécologue nantais qui se définit comme « pionnier des implants Essure » – qui estime qu’un certain nombre de patientes a été influencé par la presse. Et que le bienfait qu’elles auraient ressenti à la suite du retrait de l’implant serait lié à « des implications psychocomportementales évidentes : quand une femme attribue différents symptômes à un système, si vous enlevez le système, vous pouvez avoir ce qu’on appelle l’effet placebo, c’est-à-dire qu’elle est psychologiquement satisfaite et le symptôme peut disparaître ».
Des femmes prêtes à subir une hystérectomie (ablation de l’utérus) pour des maux secondaires, voire psychologiques ? « Un mépris finalement assez courant », admet la gynécologue Thelma Linet, qui a longtemps exercé à Nantes. « On a l’habitude de toute façon : elles [les femmes] sont folles, c’est dans leur tête, ça n’existe pas. C’est classique en gynéco, on les prend d’abord pour des hystériques. » De quoi hérisser les poils des dizaines de milliers de victimes qui ont dû subir une telle opération.
Des informations à nous communiquer ?
Écrivez-nous à contact [@] splann.org et nous vous expliquerons comment nous joindre des documents de façon sécurisée.
Contactez-nous →