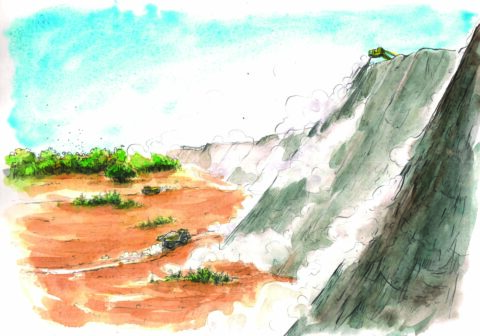« C’est ça que l’on apprend aux JA ? ». « L214 Assassins !! ». Les grosses lettres rouges sont taguées à même le sol de la ferme agricole du lycée de Bréhoulou, à Fouesnant (29). Effacés dans la journée, sans communication de la part de la direction, ces tags évoquent les tensions qui traversent le monde agricole autour des normes de bien-être animal et plus largement de l’écologie.
L’exploitation, qui sert de support pédagogique aux 305 élèves du lycée, n’est pourtant pas un modèle d’agro-écologie. Si son élevage de volailles a, un temps, été en agriculture biologique, il a été « déconverti » et ses exploitations laitières et porcines sont tournées vers une production intensive.
Idem, un peu plus à l’est en Bretagne, dans le bastion catholique de Ploërmel (56). Au lycée agricole privé La Touche, l’exploitation laitière et ses 150 vaches Holstein produisent 1,35 million de litres de lait par an. Les deux robots de traite s’activent sous les yeux d’une dizaine de parents et d’adolescents venus visiter le lycée en ce printemps 2025.
L’agriculture du futur : robotisée et intensive
« On a un élevage de 150 vaches laitières, alors que la moyenne française est de 80, on est presque deux fois plus gros que les autres. Si on n’avait que 60 vaches, on ne serait pas représentatifs de ce qu’il se passe sur terrain », explique, avec une certaine fierté, le chef de l’exploitation, qui voit passer sur sa ferme une bonne partie des 900 élèves du lycée.
-800x531.png)
Être rentable, représenter « l’agriculture du futur », attirer les jeunes… Même son de cloche du côté du lycée agricole privé Pommerit (774 élèves), situé à La Roche-Jaudy (22), et dont la ferme laitière possède, elle aussi, un robot de traite.
Les deux plus grands lycées agricoles bretons affichent la couleur. Ils possèdent également des élevages porcins hors-sol, dont les porcs charcutiers sont vendus à Evel’up (à La Touche), ou à la Cooperl (à Pommerit), les deux plus grandes coopératives d’éleveurs de porcs en France. Avec un tel tableau, difficile de s’imaginer que l’agroécologie est inscrite dans le programme des lycées agricoles. Et pourtant.
Un zeste d’agroécologie au programme
S’il n’a pas particulièrement marqué les associations par ses mesures en faveur de l’environnement, le ministre de l’Agriculture de la présidence Hollande, Stéphane Le Foll, a impulsé une petite révolution des esprits lors de son passage rue de Varenne. À partir de 2014, il lance le plan Enseigner à produire autrement, dont l’objectif est de généraliser l’enseignement de l’agroécologie dans les lycées agricoles.
« Quand Le Foll a voulu mettre de l’écologie dans les programmes, ça a été la tempête au ministère, se rappelle André Quillévéré, ancien inspecteur de l’enseignement agricole. Certains fonctionnaires freinaient la transition. Le directeur de cabinet a été persévérant, il a pris cinq ans à mettre en place ce projet. Beaucoup d’ingénieurs étaient dubitatifs sur les transitions et il y avait des résistances sur le terrain, déjà à l’époque, et dans le syndicat majoritaire (la FNSEA, Ndlr). »
En dix ans, cette impulsion pour prendre en compte « le maintien des ressources naturelles » dans l’agriculture a fait évoluer l’enseignement. Jusqu’ici entièrement tournée vers une démarche productiviste, les programmes ont fait une place à l’agroécologie. Dans les lycées publics, des exploitations ont modifié certaines de leurs pratiques, en diminuant par exemple les quantités d’intrants et de pesticides ou en mettant en place des mesures agro-environnementales (MAE), comme la plantation de haies.
Le ministère a incité les fermes à créer des ateliers en agriculture bio. « Avant, le bio, c’était inimaginable », se rappelle André Quillevéré. En 2018, il représentait 22 % de la surface totale des exploitations des lycées publics français.
Des données encourageantes… qui concernent principalement les lycées publics. Car, en termes d’enseignement à produire autrement, les établissements privés sont à la traîne. Depuis 2020, 2.600 enseignants du public ont été formés aux transitions et à l’agroécologie. Le secteur privé en a formé moitié moins. Sachant qu’en Bretagne, il scolarise 81 % des 15.518 élèves (rentrée 2024) de l’enseignement agricole.
Des fermes intensives peu exemplaires
À Quessoy (22), en plein bassin versant « algues vertes » – à quelques kilomètres de la baie de Saint-Brieuc – 592 élèves étudient dans une imposante demeure, transformée depuis 1950 en lycée agricole.
L’élevage laitier du lycée privé La Ville Davy n’a pas de robot de traite. Mais « le projet de robotisation, c’est pour début 2026 », se hâte de préciser le chef d’exploitation, en détaillant tous les avantages : « Détecter les problèmes sanitaires avec l’intelligence artificielle, avoir une organisation du travail plus simple, soulager physiquement… »
Un choix qui rime avec un système agricole intensif et conventionnel, de gros investissements et des volumes de production élevés. Un modèle économique qui, selon l’Inspection de l’enseignement agricole, est loin d’être le plus rentable.
Dans un rapport de 2023, elle indique que sur 228 exploitations de lycées agricoles en France, seules 54 étaient à l’équilibre financier. Aucune exploitation bretonne n’en faisait partie, excepté le centre équestre du lycée public Kernilien à Guingamp (22). Une de ses principales recommandations est de « diminuer significativement la dépendance aux intrants en tendant le plus possible vers l’autonomie, notamment pour les productions animales ». Dans un autre rapport de 2017, l’Inspection observe, chiffres à l’appui, que les exploitations ayant le plus recours aux pâturages sont aussi les plus rentables.
-800x531.png)
À La Ville Davy, l’ancien directeur du lycée (2009 à 2021), Bernard David, affirme pourtant avoir poussé l’exploitation à aller vers un système plus résilient et autonome. Sous sa direction, des travaux de modernisation ont été menés en 2015 – soutenus par la Région Bretagne à hauteur de 300.000 euros – et la part d’herbe dans la ration des vaches est passée de 20 à 70 %. La ferme a aussi rejoint une Cuma (coopérative d’utilisation des matériels agricoles) pour limiter l’investissement dans du matériel.
Mais ces efforts, explique-t-il, ne sont pas gravés dans le marbre. Peu après son départ du lycée, « un nouveau chef d’exploitation a été recruté. Et la première chose qu’il a faite, c’est d’investir 500.000 euros dans un tracteur ».
Pour Jeanne*, professeure dans un lycée privé, ces fermes intensives et robotisées influencent les élèves. Ce qu’elle a constaté, lorsqu’elle a fait passer le grand oral : « Dans la journée, j’ai eu cinq sujets sur les robots de traite [les sujets sont choisis librement par les élèves, Ndlr] ! Pourtant, ces pratiques ont des conséquences environnementales monstrueuses : les vaches ne sortent plus dehors, elles sont nourries à l’ensilage… »
L’agriculture paysanne et biologique, à la marge
« Le modèle dominant reste quand même le modèle d’élevage intensif dans beaucoup d’établissements, privés ou publics », constate André Quillevéré. « Il y a de grosses résistances de la profession à mettre en œuvre les dispositions que l’on préconise », déplore l’ancien inspecteur, qui a aussi été directeur du lycée public Le Gros Chêne, à Pontivy en 2024.
Quant à la place de l’agriculture bio, elle reste marginale. Comme au lycée du Nivot (29), où un ouvrier de l’exploitation l’affirme clairement, levant les yeux au ciel : « Le rucher bio, ici, c’est vraiment anecdotique ! »
Au lycée public de Bréhoulou, à Fouesnant (29), l’atelier de volailles – des poulets de chair vendus via le groupement de producteurs Les Fermiers de l’Argoat – est passé en bio en 2017, avant de rétropédaler en 2021. « Ce n’est pas une volonté de notre part mais un retournement de marché », explique la direction du lycée. La viande est désormais vendue sous Label Rouge.
À l’échelle de la Bretagne, seuls deux lycées, tous deux publics, ont converti leurs exploitations à l’agriculture bio : le lycée Suscinio à Morlaix (29), pour le maraîchage, et le lycée Théodore-Monod, au Rheu (35), avec du maraîchage, une ferme laitière et porcine. Pourtant, même dans ce cas-là, l’élevage reste en système dit « intégré ».
Au lycée du Rheu, l’exploitation porcine travaille avec une coopérative bio en circuit long, Biodirect. « Les aliments sont achetés et non produits sur place, on ne peut pas dire que ce soit le système le plus vertueux », détaille Dominique Blivet, enseignant dans l’établissement jusqu’en juin 2024, et porte-parole du syndicat Sud Rural Territoires.
Un verdissement cosmétique
Si le label qui rencontre le plus de succès n’est pas l’AB, c’est qu’un autre, mis en place par le ministère de l’Agriculture, a remporté l’adhésion de la profession. Le label Haute valeur environnementale (HVE), est mis en avant par 52 % des fermes des lycées agricoles publics. Il est pourtant remis en cause par la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) mais aussi par UFC-Que Choisir pour « tromperie ».
C’est bien simple, pour Philippe Cousinié, animateur national Transition agroécologique dans l’enseignement agricole, c’est même « du greenwashing », car « ce n’est pas contraignant, ça ne demande aucun effort pour nos fermes ». Le label exige ainsi 4 % d’infrastructures écologiques (haies, prairies…), un pourcentage déjà atteint dans les exploitations des lycées agricoles.
La Fnab défend, de longue date, la mise en place d’heures dédiées d’enseignement de l’agriculture biologique dans les programmes. Présentée par le groupe insoumis, lors du vote de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, cette proposition n’a pas été retenue. « Il n’y a pas de précision de durée, de définition précise de l’agroécologie ou des pratiques qui l’englobent, rendant la notion bien difficile d’appropriation pour les enseignants », regrette la Fédération nationale de l’agriculture biologique.
Les référentiels liés à l’agroécologie, ou aux transitions, sont « dilués » dans l’ensemble des programmes, ce qui paradoxalement donne aussi la possibilité de ne pas l’aborder. « Pour moi, il n’y a pas de transition et d’agroécologie sans engagement, observe Philippe Cousinié. Si les enseignants sont opposés à l’agriculture bio, ils ne vont pas forcément investir le sujet. » Au manque « d’engagement » de certains enseignants ou d’équipes à aborder l’agroécologie, s’ajoute aussi une certaine forme d’auto-censure.

Auto-censure et rejet de la bio
« Certains profs n’osent plus y aller, ils ont essayé, ont vu que le terrain était glissant et se sont dégoûtés », observe Gaëtan Bourdon, professeur d’aménagement-environnement au lycée privé Kerlebost.
Face à des élèves issus du milieu agricole, ayant un haut niveau technique et des attentes très précises concernant l’agriculture intensive, certains professeurs ne se sentent pas légitimes. « Les élèves avaient des attentes vers une agriculture de pointe super technologiste et moi, qui suis plus spécialisée sur l’agroécologie, je me sentais en porte-à-faux par rapport à eux », explique ainsi Geneviève Sagare, ingénieure agronome et professeure au lycée Pommerit.
Chez certains élèves, l’agroécologie est marquée par un rejet très fort. « Une majorité d’entre eux sont par principe anti-bio », détaille Marie Cadou, qui a été enseignante au lycée Kernilien (Guingamp, 22). Ils reprennent l’idée d’une agriculture biologique aux mains du lobby écolo, alimentée par la théorie de l’agri-bashing. »
La théorie de « l’agri-bashing », affirmant que les agriculteurs sont la cible d’un dénigrement systématique, a notamment été reprise par le ministère de l’Intérieur lors de la création d’observatoires de l’agri-bashing en 2019. Leur activité s’est révélée, selon le journal Le Monde, « très limitée, voire nulle ».
« Dès que tu entends le mot écologie, ça peut huer dans tous les sens. J’y vais avec de la prudence, j’essaye de manier de l’humour et un peu de provoc’ », détaille Dominique Blivet. Jeanne* nous raconte, elle aussi, avoir été marquée par une ambiance générale pro agro-industrie dans le lycée privé où elle enseigne : « Quand on parle du bio ça ricane. » Résultat : peu d’élèves osent affirmer leur intérêt pour l’agriculture biologique. « Une élève cachait carrément que ses parents sont en agriculture bio et très actifs dans le réseau paysan ! »
Un accompagnement de la Draaf défaillant ?
L’enseignement aux transitions est pourtant une des nouvelles missions de l’enseignement agricole, définie par la loi d’orientation agricole, votée en mars 2025. Dans le plan de mise en œuvre de cette loi, le ministère lance un nouveau programme pour l’enseignement à produire autrement, qui devrait entrer en application en septembre 2026. Le programme insiste sur le rôle des exploitations agricoles, qui doivent devenir des « démonstrateurs des transitions ».
Une volonté qui tranche avec l’essoufflement constaté à l’échelle de la Bretagne, dans la mise en place et le suivi d’un enseignement de l’agroécologie. Un suivi assuré par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne (Draaf), sous la tutelle du ministère de l’Agriculture.
Pour cela, la Draaf Bretagne dispose d’un outil à coconstruire avec les établissements : le plan régional Enseigner à produire autrement (Prepa). Ce projet permet d’identifier des objectifs à atteindre, sur une période de quatre ans, pour chaque lycée.
Pourtant, la Draaf Bretagne n’a pas respecté l’injonction faite par le ministère, en 2020, de lancer un nouveau plan régional. Elle nous a informés que le document régional « était resté à l’état de projet depuis 2020 » et qu’il « n’a pas été publié ». L’institution a décliné toutes nos demandes d’entretiens. Et ceci, alors même que le chantier sur le sujet nécessitait un important volontarisme politique. Dans le plan précédent, lancé en 2014, la Draaf constatait d’ores et déjà un important déséquilibre entre lycées publics et privés dans leur investissement sur ce sujet.
Plus globalement, et au-delà du manque de rigueur dans la production du document, le contenu et l’application même de ces plans posent questions.
Il n’existe quasiment pas de référent sur les questions de transitions dans les lycées privés. Le lycée Kerlebost est un des seuls dont le référent, Gaëtan Bourdon, s’est vu attribuer une demi-journée par semaine sur cette mission. « Quand j’ai commencé, j’ai dit : « On arrête avec les tableaux Excel et on passe à l’action », explique l’enseignant. Il a lancé un programme de plantations et de restauration des haies existantes et multiplie les projets sur la biodiversité ou la réduction de l’usage de pesticides.
Au lycée La Touche à Ploërmel, le référent Enseigner à produire autrement n’est autre que le directeur adjoint. Ce dernier admet qu’après dix ans de plans à produire autrement, les plus récentes actions sont « le changement des ampoules en LED » et « sensibiliser les élèves au gaspillage à la cantine ».
Le principal objectif du plan à enseigner autrement 2020-2024 du lycée La Touche concernant les cultures était « d’orienter une partie de l’exploitation en agriculture biologique ». Dans un tableau de projection, le document prévoit même « 100 % en 2025 ». Cinq ans plus tard, aucun atelier n’est en agriculture biologique sur la ferme.
Selon le directeur adjoint, « avoir un atelier bio pour faire joli ça n’a pas de sens, et, quand on voit le marché de l’agriculture bio, c’est compliqué d’équilibrer. Notre mode de production est aujourd’hui en phase avec ce qui se fait et avec les attentes sociétales vu de notre fenêtre ».
Boite noire
Pour documenter notre article sur l’agroécologie au programme des lycées agricoles, nous avons utilisé le Plan régional « Enseigner à produire autrement » 2016-2020 en ligne sur le site de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne (Draaf).
Nous avons demandé à la Draaf Bretagne le Plan régional couvrant la période 2020-2024, qui n’était lui pas en ligne. La Draaf Bretagne nous a indiqué que le document était à « l’état de brouillon » depuis 2020. « Le nouveau PREPA post 2024 n’a jamais été formellement validé du fait du renouvellement de l’équipe de direction en 2024 et n’a donc pas été publié », a indiqué le service communication de la Draaf Bretagne.
Nous avons fait appel à la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui a émis un avis favorable à notre demande. La commission a bien précisé dans son avis que « sont considérés comme documents administratifs (…) notamment les dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Malgré nos demandes répétées, nous n’avons pas pu échanger de vive voix avec le Service régional de la formation et du développement, le service de la Draaf Bretagne qui s’occupe en particulier du suivi et de l’accompagnement des lycées agricoles, et donc de l’application de l’enseignement à produire autrement en Bretagne.
Nous avons aussi tenté d’échanger par mail ou par téléphone avec l’Inspection de l’enseignement agricole, qui dépend du ministère de l’Agriculture, mais n’avons pas eu de retour écrit ou oral à nos questions.
Nous déplorons ce manque de dialogue de la part d’institutions publiques sur des sujets d’intérêt général, concernant des établissements et des politiques financées par de l’argent public.
Illustrations par Atelier Lugus
Des informations à nous communiquer ?
Écrivez-nous à contact [@] splann.org et nous vous expliquerons comment nous joindre des documents de façon sécurisée.
Contactez-nous →